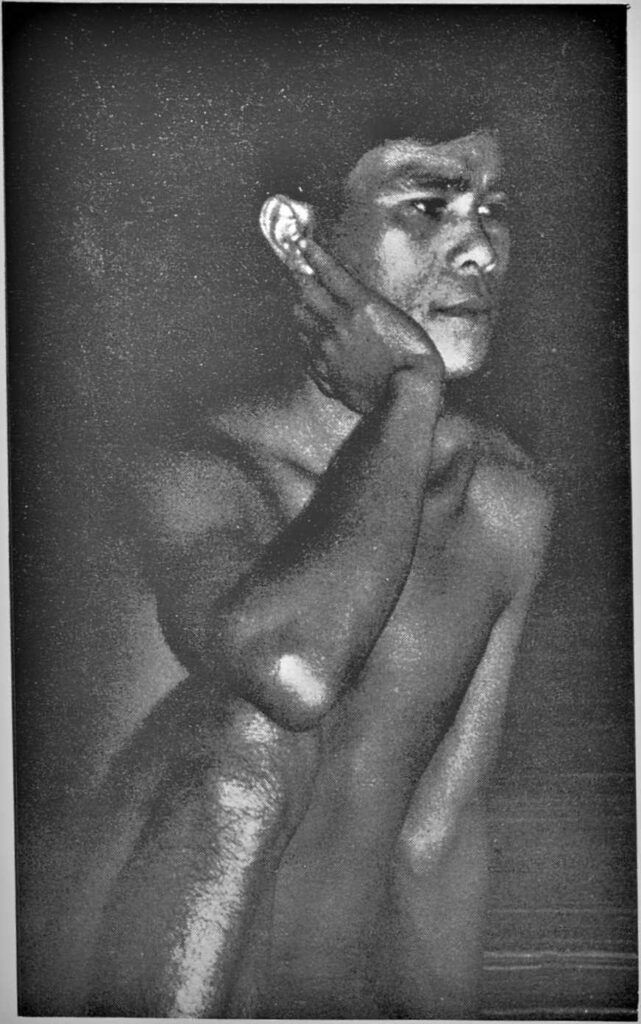Ce document est consultable à la bibliothèque asiatique suivant la cote « H DOU 65 »
Vie de l’esprit ; la langue et le style oral
La langue parlée par les Jörai, par tous à quelques différences de prononciation près, est du groupe austronésien, très proche du cham et de dialectes proto-malais répandus en Indonésie. Quand on possédera assez de dictionnaires et d’études comparatives, on pourra délimiter l’aire culturelle de cette population si remarquable dans le sud-est asiatique.
La littérature jörai est orale. La transcription de la langue en écriture romanisée ne présente qu’une difficulté : c’est de parvenir à l’uniformité, et cela pour deux raisons : d’une part il n’existe ni tradition, ni académie pour servir de principe directeur et d’autorité exécutive, d’autre part les variantes de réalisation ne permettent pas d’en imposer une comme meilleure (ce qui se prononce ai ici, par exemple, s’entend ei plus loin, ie en eddê). Les Jörai ont été dotés, par des étrangers, d’une écriture, mais plusieurs systèmes de transcription se concurrencent. Cela n’a pas une grande importance pour les usagers qui ont moins besoin d’écrire leur langue que d’apprendre la langue du pays où ils résident, moyen d’acculturation et d’ouverture au monde ; mais cela gêne les chercheurs, l’impropriété de l’écriture pouvant rendre le mot méconnaissable et faire barrière aux études comparatives qui s’imposent. Et cela d’autant plus que, pour des ethnies aussi différentes que Mà’, Eddê, Bböhnar, le nombre des phonèmes communs (voire de sémantèmes complets) invite au rapprochement, défavorisé par la pluralité des transcriptions.
Bien que la langue jörai soit polysyllabique, la majorité des mots (pour autant qu’on puisse justement isoler des « mots ») est monosyllabique, ou à deux syllabes dont la première est si faible qu’elle est parfois élidée (a initial, ou son ö voisin du e muet). Sans flexion, elle utilise l’affixation (préfixes, infixes, suffixes). Sans tons, elle marque des accents, sur telle syllabe dans le mot, sur tel mot dans la phrase. Sans conjugaisons ni déclinaisons, sa syntaxe est caractérisée par des relations de position, ce qui est harmonisé avec les structures sociales et l’esprit du Jrai, qui pense par séries de rapports.
Apparemment simple pour un Occidental, rebuté par les tons du viêtnamien ou du thai, le jôrai est difficile à bien parler en raison de ses groupes de consonnes et surtout des glottalisées. Le Jörai trouve que le viêtnamien lui est moins étranger que le français, lequel lui fut naguère plus difficile à apprendre que l’anglais aujourd’hui. On répète, comme un cliché, que jörai et langues voisines ont un vocabulaire très réduit et pauvre en abstractions ; certes le Jörai dispose d’une grande variété de termes concrets et il s’étonne que le Français appelle toujours « bambou » des espèces qui sont pour lui aussi différentes que le sapin et le chêne pour nous. Mais la langue des mythes est, par sa richesse et ses nuances, un défi au traducteur, et le français est bien pauvre quand il faut rendre une de ces nombreuses expressions complexes telles que : jöngum, sentiment d’aise qu’on éprouve quand on est nombreux ensemble, ou son contraire hial, sentiment de malaise venant du fait qu’on n’est pas en compagnie suffisante. On a tendance à juger une langue du point de vue du fabricant de thèmes (comment dire « analyse » en jörai ?), alors qu’il est plus objectif de prendre comme point de départ la langue étudiée.
Avec un lexique très limité de mots usuels, un étranger peut se faire comprendre du Jôrai qui, sauf s’il a décidé que cet étranger ne peut pas parler sa langue, a assez d’esprit pour se contenter d’incorrections et les interpréter ; mais l’étranger ne comprendra pas le langage du Jörai qui s’exprime habituellement par couples de mots, par couples de couples, et mieux encore par formules rythmées. C’est la structure même du style oral.
Dits de justice pour régler les différends, dits de religion pour exécuter les rites, lamentations funèbres des pleureuses ou cours d’amour, mythes et proverbes sont des récitations de formules enchaînées dont la conversation courante est émaillée et ne se peut bien comprendre que dans ce contexte, en raison des allusions et connotations.
Ces récitations, transmises de bouche à oreille, de génération en génération, avec un système mnémotechnique (ainsi la dernière syllabe accentuée d’une formule accroche par assonance la première accentuée de la formule suivante), constituent la base de la culture jörai. N’ayant d’autre organe que vivant, celle-ci partage le sort de tout vivant, en évolution constante, chaque état étant provisoire et périssable. Il en va de même pour les industries jôrai, essentiellement à base de végétaux ; la maison, par exemple, ne dure qu’une génération ou deux, mais son type se perpétue, avec des matériaux renouvelés. Contrairement à un prétendu fixisme, une telle civilisation « archaïque » est, à l’inverse de celles qui se figent dans la pierre et l’écriture, vie et donc mouvement, fidélité à un génie propre à travers des modifications de réalisation. Un mythe n’existe que vécu ; on n’en entend jamais deux fois le même récit, pas plus qu’on ne se baigne deux fois dans la même eau de rivière.
La suite du texte est consultable au format PDF.