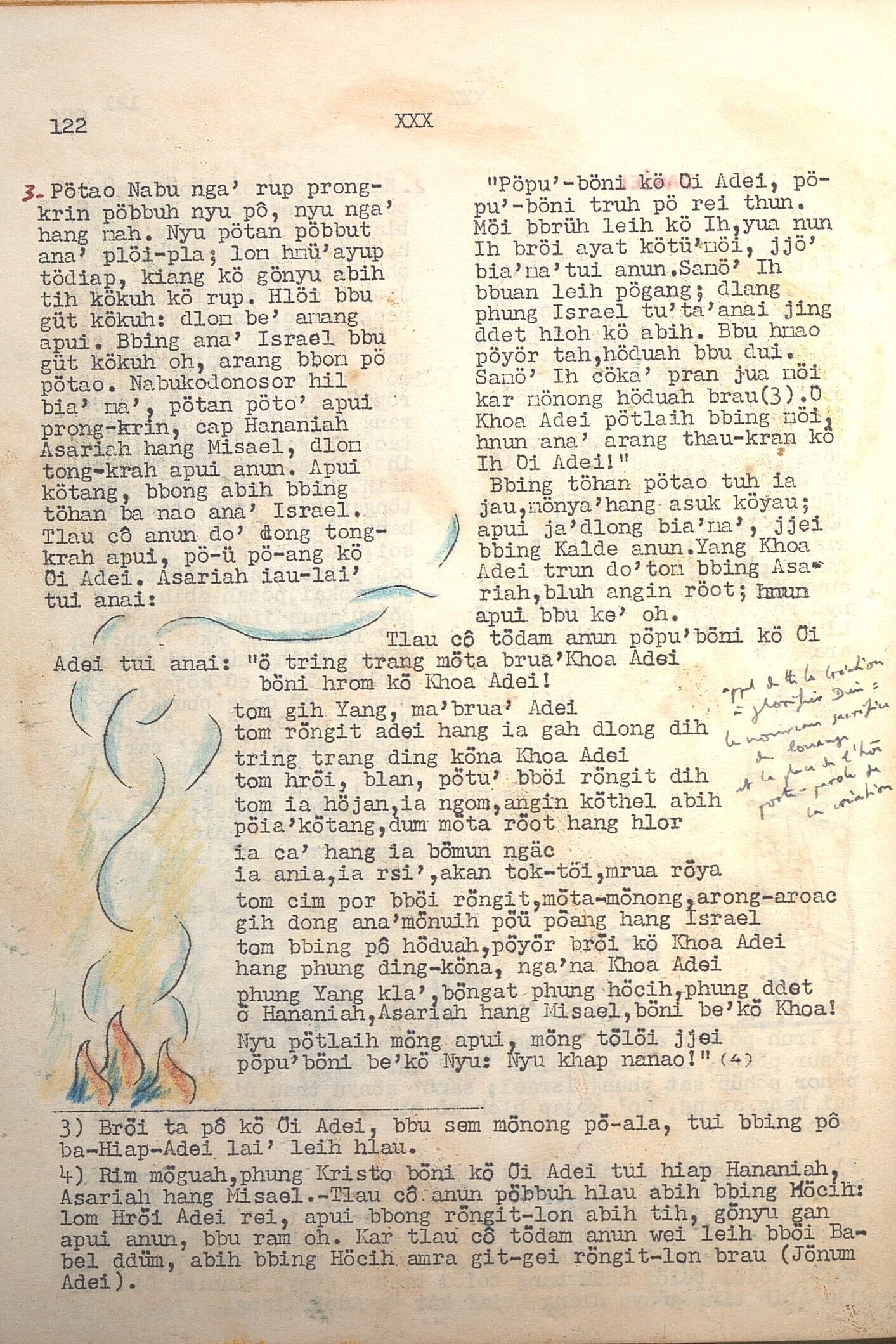« Je suis né à Saïgon en 1946, j’avais 24 ans »
- 1922 : naissance dans un milieu bourgeois, enfance studieuse
- 1940 : baccalauréat de philosophie et mathématiques, entrée au grand séminaire de Versailles
- 1945 : ordination sacerdotale pour la Société des Missions étrangères de Paris (MEP). Désir de lointains et de confrontation à l’altérité
- 1946-1954 : 8 ans de mission au sein de l’ethnie sré
- 1949 : publication d’un dictionnaire sré. Participation à la commission de fixation officielle de la transcription de la langue sré
- 1954 : fin de l’Indochine française. Les Hauts-Plateaux du Centre dépendent administrativement de la nouvelle république du Sud Vietnam
- À partir de 1955 : installation sur les Hauts-Plateaux de réfugiés du Nord-Vietnam et arrivée massive de colons agricoles vietnamiens
- 1954-1955 : doutes vocationnels, retraite spirituelle en Algérie sur les pas de Charles de Foucauld
- 1955-1968 : 13 ans de mission au sein de l’ethnie jörai
- 1957 : publication par Georges Condominas de Nous avons mangé la forêt, sur son étude de terrain chez les Montagnards de Sar Luk
- A partir de 1959, insécurité grandissante sur les Hauts-Plateaux, déplacements de populations villageoises montagnardes
- 1962 : séjour à Rome pour l’ouverture du concile Vatican II
- 1963 : publication de Dieu aime les païens, premier ouvrage de théologie
- 1964 : séjour à Rome pour la deuxième session du concile Vatican II, en tant que peritus (expert) en missiologie
- 1964 : publication d’un dictionnaire jörai
- 1968 (janvier) : en disponibilité, rentre à Paris pour soutenir à l’EPHE son mémoire Bois-Bambou, aspect végétal de l’univers Jörai. Elu membre du CEDRASEMI
- 1969 : « voyage en triangle » à Sumatra et Bornéo, dans une optique de comparaison des cultures austronésiennes
- 1970 : retour définitif en France, éloignement de la Société des MEP sans rupture définitive
- 1972 : soutenance de sa thèse de 3e cycle intitulée Coordonnées : structures jörai familiales et sociales
- 1972-1987 : à Paris, en poste de recherche au CNRS
- 1973 : soutenance devant Claude Lévi-Strauss de sa thèse d’Etat consacrée au Pötao, une théorie du pouvoir chez les Indochinois jörai
- 1975 : participe à la création du groupe de recherche « Oralité et domaines oraux » à l’INALCO
- 1993 (mars) : décès chez lui dans le Gard, sépulture dans le cimetière des MEP
Sré et Joraï : deux ethnies de « Montagnards » sur les Hauts-Plateaux du Vietnam
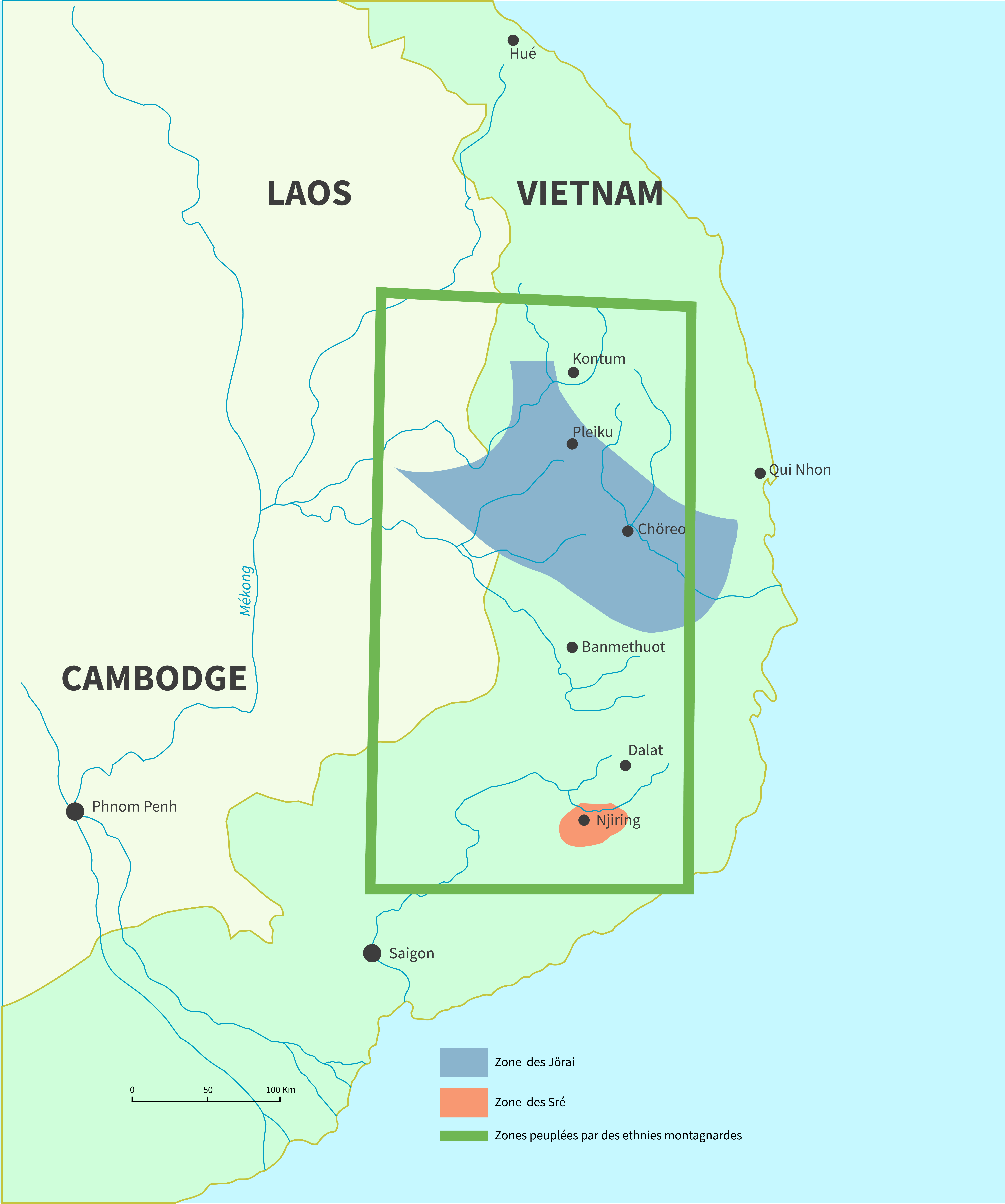
Aux confins du Vietnam, du Laos et du Cambodge, une longue bande de terre, s’étendant sur 600km du Nord au Sud, compte plus de 50 minorités ethniques, toutes dotées de leurs propres langues et traditions. Il s’agit de plateaux d’une altitude moyenne de 600m, abritant actuellement, pour le seul Vietnam, environ 1,3 millions de membres de ces ethnies. Désignés jusqu’au milieu du XXe siècle par le vocable péjoratif de « Moïs » (« Sauvages »), ceux-ci sont aujourd’hui plus volontiers appelés « Montagnards ».
D’ethnie en ethnie, langues et coutumes diffèrent, mais décor et organisation sociale sont communes. Toutes ont pour cadre de vie la forêt, qui couvre les sommets (jusquà 2000m) comme les plaines arrosées par les affluents du Mékong. Pour dégager les zones nécessaires à la culture du riz paddy, les Montagnards pratiquent l’essartage (défrichement par brûlis et jachère forestière) : ils « mangent la forêt », comme l’a poétiquemet énoncé Georges Condominas. Du fait de cette limitation de l’espace par un monde végétal prédominant, le village est l’entité sociale la plus adaptée, au-dessus de laquelle n’existe pas de structure hiérarchisée.
Intéragissant beaucoup entre eux, les Montagnards ont toujours eu des contacts plus limités avec les populations vietnamiennes, qui les regardèrent d’ailleurs longtemps d’un œil intrigué. Bien avant les colons français, les prêtres de la Société des Missions étrangères de Paris (MEP) ont été les premiers occidentaux à venir à leur rencontre, à partir de 1849. A l’exception de la mission bahnar développée dans la région de Kontum, les « missions des Hauts-Plateaux » demeurèrent toutefois modestes jusqu’à la seconde Guerre mondiale.
C’est dans ce contexte qu’arrive en 1946 le jeune missionnaire Jacques Dournes, envoyé par l’évêque de Saïgon pour partager la vie de l’ethnie sré, au sud de Dalat. Dix ans plus tard, le P. Dournes changera de mission pour s’installer plus au nord, auprès de la grande ethnie des Jörai (env. 320 000 membres), qui restera jusqu’à sa mort l’objet principal de son affection et des ses études.

Montagnard parmi les Montagnards : 25 ans d’ethnologie totale
Comme tout prêtre des MEP arrivant dans un pays de mission qu’il n’a pas choisi, le P. Dournes n’a préalablement été doté d’aucune formation dédiée. Pourtant, c’est par deux reprises (en 1946 à Kala chez les Sré et en 1955 à Cheo Reo chez les Jörai) qu’il doit s’immerger, seul, dans un univers jusqu’alors peu perméable aux influences coloniales et ecclésiales. Ce jeune urbain de 24 ans arrive dans son premier poste avec une valise de livres et une machine à écrire pour seuls objets d’importation. Les premières semaines sont dédiées à la construction de sa hutte-chapelle en bambou local. La nourriture est celle que lui partagent les quelques familles qui ouvrent leur intérieur à cet étranger qu’elles n’ont pas appelé.
A son départ du Vietnam, après un quart de siècle uniquement dédié à ce terrain, il a publié 10 ouvrages de théologie et de linguistique, plus de 200 articles d’ethnographie et de botanique, amassé le matériel nécessaire à la rédaction des deux thèses et nombreuses publications qui suivront. Une telle production révèle un travail acharné jusqu’à vivre une « intimité avec la culture contemplée ».
Il eut le bénéfice du temps long : le missionnaire part pour la vie. Sans avoir été préméditée, ma méthode de recherche était liée à mes conditions d’existence en pays jörai – comme en pays srê précédemment. J’avais le temps de me laisser lentement imprégner, procédant à une quête diffuse plutôt que menant des enquêtes systématiques. Surtout, il a recherché la maîtrise de la langue locale jusqu’au dépouillement de la langue natale comme préalable à toute connaissance : Je me livrai à une étude du dedans, prenant mes notes en langue jörai, pour ne pas risquer d’interpréter trop tôt.
Une production documentaire colossale
Dournes, en bon ethnologue, remplit des carnets d’observation, dresse des schémas topographiques et techniques, photographie, reproduit paysages et visages à l’aquarelle, enregistre et transcrit. Il parvient à documenter tous les aspects de l’environnement naturel et de la culture matérielle. Il peut compter sur une rare force de travail, amplifiée par un mode de vie solitaire et ascétique. Souvent décrit par ses interlocuteurs occidentaux comme rigide et froid, il ne semble pas avoir été restreint par ce trait dans ses relations avec les Montagnards. Il bénéficie aussi d’une facilité pour l’écriture, faisant montre de rigueur et de précision.
Son cadre géographique ne s’est pas limité aux deux communautés ethniques dont il avait la charge pastorale. Chaque année passée sur les Hauts-Plateaux lui faisait entreprendre des « tournées » à la fois missionnaires et exploratoires, dans des groupements de villages ou des ethnies voisines, annotant ses carnets au soir de journées de marches sur des pistes escarpées. De ces comparaisons des langues et usages, il tire ses études en anthropologie sociale et politique.
Quant au but poursuivi par ses publications, Dournes se défend d’avoir étudié les Jörai « pour le plaisir pur », mais pour les faire connaître aussi, ce qui était une façon de plaider la cause des minorités originales et mésestimées.
Des cultures vivantes, qui évoluent
Qu’est ce que les Jörai pensent ? Voilà la question
Dès les premières années, et là est son génie, il a l’intuition que la culture matérielle est un tremplin vers l’immatériel, vers la connaissance profonde de l’homme, démarche qu’il qualifie « d’anthropologie culturelle de fond » : « Comment l’homme, pieds nus dans la rizière réfléchit, réagit — c’est ça qui est intéressant ». Ce désir de dévoiler l’imaginaire, d’interpréter le penser à l’aide du parler a motivé ce qui fut son principal objet d’étude jusqu’à la fin : le patrimoine littéraire oral des Montagnards. Sans le savoir, Dournes pratiquait déjà l’ethnoscience conceptualisée par Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage (1962).